Entretien avec Nicolas Doutey, par Ismaël Jude.
Nicolas Doutey est chercheur associé au LAPS. Il était l’invité du séminaire du mois de février. Deux de ses pièces, Je pars deux fois et Jour, ont fait l’objet à Théâtre Ouvert d’une session de l’Ecole Pratique des Auteurs de Théâtre animée par Alain Françon en 2011 et d’une réalisation pour France Culture par Alexandre Plank et Baptiste Guiton dans le cadre de « La radio sur un plateau » en 2012. Il s’explique sur sa double activité d’auteur dramatique et de théoricien de la scène.
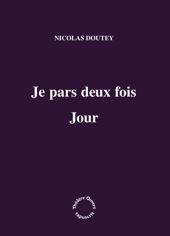 Ismaël Jude : Tes pièces Jour et Je pars deux fois viennent d’être publiées dans la collection Tapuscrit de Théâtre ouvert [1]. Le LAPS te connaît comme chercheur. Nous t’avons récemment entendu au sein du séminaire mensuel du LAPS développer à partir des textes de Beckett une hypothèse de définition de la scène percutante, très originale (cf. compte rendu du séminaire avec Nicolas Doutey). Dans des termes inspirés de Wittgenstein, Rorty et Dewey, tu décris la scène comme un dispositif qui rend disponible la signification. Que reste-t-il de tes recherches, particulièrement ce qui concerne le lien théâtre-philosophie dans tes textes de théâtre ? J’ai l’impression que tu veux dire quelque chose du fait théâtral dans ces textes. Je me trompe ?
Ismaël Jude : Tes pièces Jour et Je pars deux fois viennent d’être publiées dans la collection Tapuscrit de Théâtre ouvert [1]. Le LAPS te connaît comme chercheur. Nous t’avons récemment entendu au sein du séminaire mensuel du LAPS développer à partir des textes de Beckett une hypothèse de définition de la scène percutante, très originale (cf. compte rendu du séminaire avec Nicolas Doutey). Dans des termes inspirés de Wittgenstein, Rorty et Dewey, tu décris la scène comme un dispositif qui rend disponible la signification. Que reste-t-il de tes recherches, particulièrement ce qui concerne le lien théâtre-philosophie dans tes textes de théâtre ? J’ai l’impression que tu veux dire quelque chose du fait théâtral dans ces textes. Je me trompe ?
Nicolas Doutey : Tu ne te trompes pas du tout. Enfin, je ne sais pas si c’est aussi net que « vouloir dire » quelque chose sur le théâtre, comme un discours qu’on devrait déduire des pièces. L’idée de la pièce à message qui délivre un sens tout prêt et bien ficelé – quel que soit sa nature – ne m’intéresse vraiment pas du tout. Si une œuvre se résume à un message, je me dis qu’il vaut mieux écrire directement le message (dans un essai, un article, etc.). C’est probablement parce que j’ai une très forte capacité d’ennui, ou d’impatience, mais en tant que spectateur, si j’ai l’impression qu’on passe une heure à me dire ou montrer quelque chose qui peut être dit sans perte en trois phrases, j’ai du mal à le supporter (c’est aussi un problème par rapport à une certaine manière de traiter la fiction, quand on sait où ça va et qu’on ne fait plus qu’attendre que ça arrive – Gertrude Stein parle de ça, Heiner Müller aussi quelque part je crois). J’essaie d’avoir ça en tête quand j’écris, qu’une œuvre doit pouvoir justifier sa durée, il faut que l’œuvre requière l’expérience concrète du spectateur, sinon on aurait mieux fait de rester chez soi.
Ceci étant dit, j’ai la tête théorique, je mène des recherches sur le théâtre, et je ne suis pas schizophrène. Ce que mes pièces ne sont pas, c’est l’application « pratique » d’une recherche théorique – ce qui effacerait toute surprise, et la surprise est importante pour moi dans l’écriture, la sensation de découverte. Mais évidemment, je peux faire des ponts entre mes recherches théoriques et mon travail d’écriture ; et sans que mes pièces visent un message, certains éléments qui y sont (et les pièces dans leur globalité) témoignent, je crois, d’une certaine idée du fait théâtral, et la travaillent. Parfois des éléments théoriques nourrissent l’écriture, mais la plupart du temps, j’ai quand même l’impression que c’est plus précis dans l’écriture.
Pour répondre à ta question, il y a certains motifs que je peux repérer. D’abord, j’ai pas mal tourné autour de Wittgenstein, et je crois qu’à certains égards j’ai travaillé sur l’idée – très librement tirée de ma lecture ! – qu’on dit moins ce qu’on dit qu’on n’interagit avec ce qu’on dit (au moyen de ce qu’on dit, et avec ce qu’on dit d’ailleurs), parler est agir, ça n’a rien de neutre. C’est une évidence absolue, mais je l’ai travaillée et poussée, et j’ai eu l’impression que ça produisait quelque chose de théâtral – parallèlement, dans ma recherche, j’ai analysé la dimension théâtrale de la conception wittgensteinienne du langage. Sous un angle tout à fait différent, une des sources de Je pars deux fois a été le problème philosophique des relations du corps et de l’esprit – mais je crois que, sinon formellement dans la question union/séparation, la trace n’en est plus très visible, ça a pourtant été un des moteurs.
En général, mes réflexions dans l’écriture sont plutôt de nature éthique. Je crois que j’ai un côté un peu utopiste dans ma manière d’aborder le théâtre, que je vois comme un lieu où l’on peut inventer et expérimenter des types de comportements, de conduites, des manières d’être. C’est peut-être par là que ça rejoint la philosophie d’ailleurs, dans sa dimension idéelle : inventer des manières de se comporter, de penser, etc. Par rapport à cette idée un peu utopiste, j’ai essayé de travailler des situations et des comportements où les gens ne dramatisent pas (au sens où on dit « c’est un drame / c’est une catastrophe ») mais plutôt dédramatisent. Et l’outil principal de cette dédramatisation, c’est l’absence de jugement. Je pense, de manière extrêmement naïve (j’en suis conscient, mais bon), que beaucoup de choses négatives seraient évitées si on pratiquait moins de jugements. Ça communique, côté philosophie, avec ce que dit Deleuze sur la possibilité de libérer le théâtre de la catégorie du jugement. Il y a peut-être une affinité à penser entre le jugement et l’intensité dramatique (ou tragique) à quoi mène la dramatisation, et réciproquement une affinité à penser entre dédramatisation et suspension du jugement. La question de la dédramatisation implique aussi certaines choses au niveau de la fiction : dans les pièces, il y a beaucoup de choses qui ont un « potentiel » dramatique (et de fictionnalisation, ou d’épaississement de la fiction, de complication des lignes fictionnelles) qui ne sont pas développées, précisément pour éviter de dramatiser.
IJ : Il suffirait, par exemple, de remplacer « cette île » par « une scène » dans cette réplique de Paul dans Jour : « Et vous savez ce qu’il y a de particulier sur cette île, c’est qu’elle est si vide et que tout se délimite et se dessine de manière si précise. Tout est très visible. J’ai l’impression d’être sur une carte, aussi visible et sans défense qu’un poteau indicateur, qu’un poteau indicateur qui indiquerait ma présence, ma situation et mon état d’âme. En plein jour. »
 « Une grande bizarrerie s’installe » alors par le simple fait pour les acteurs d’être là (sur cette île ou cette scène) qui fait naître des gestes et des paroles inhabituels. Ce « quelqu’un » qui vérifie que l’île soit bien déserte et bien balayée par les vents dont les personnages ont l’intuition correspond-il au regard de spectateurs ? Ton but est-il d’exposer la bizarrerie de cette île que constitue la scène ?
« Une grande bizarrerie s’installe » alors par le simple fait pour les acteurs d’être là (sur cette île ou cette scène) qui fait naître des gestes et des paroles inhabituels. Ce « quelqu’un » qui vérifie que l’île soit bien déserte et bien balayée par les vents dont les personnages ont l’intuition correspond-il au regard de spectateurs ? Ton but est-il d’exposer la bizarrerie de cette île que constitue la scène ?
ND : Ce n’est pas un « but », mais tout à fait, ça a été un des éléments dans le feuilletage, une des donnes de travail. Il y en a pas mal d’autres, mais j’aime les pièces qui ne cherchent pas à vous faire oublier que vous êtes au théâtre. Je trouve que le « théââtre » ne revient jamais plus fort, ne vous frappe jamais plus et de manière plus détestable que quand on essaie de le faire oublier. C’est une chose qui me préoccupe beaucoup : faire en sorte que le texte de théâtre soit écrit pour la scène (c’est-à-dire : pas pour un écran, pas pour la page d’un roman, etc.), et que la fiction, en un sens, accueille le théâtre (ou en tout cas n’exige pas qu’on le dénie). Chaque forme a des spécificités. Et il me semble crucial de les prendre en compte. Pour ma part, la plupart des fois où je m’ennuie au théâtre, c’est quand je ne vois pas pourquoi on est au théâtre, pourquoi ce qui se passe sur scène se passe sur scène, en présence d’un public, etc.
Je crois que c’est une manière d’écrire pour le théâtre que de penser aussi les fables en termes théâtraux. Je ne suis pas dans un refus absolu de la fiction, mais, au théâtre, j’aime les fictions-théâtrales (de même que j’aime au cinéma les fictions-cinématographiques, etc.). C’est une évidence, c’est un peu bête, mais ça se travaille dès l’écriture. J’essaie d’écrire pour le théâtre, ou déjà dans le théâtre. C’est vrai aussi pour Je pars deux fois. Une des premières images qui m’est venue dans l’écriture de la pièce, c’était celle d’un spectateur à qui son voisin parle tout le temps et qui du coup lui répond vite (voire à côté) pour rester concentré sur la pièce. On pourrait dire que Paul et Pauline sont des spectateurs de quelque chose qu’ils n’arrivent pas à cerner, et à qui il n’arrête pas d’arriver plein de choses qui les déconcentrent. Bon. Et dans Jour, ils sont spectateurs aussi (touristes, promeneurs), mais ils se rendent compte aussi qu’ils sont acteurs malgré eux, enfin moins tout à fait acteurs qu’objets visibles sur scène (et la peur viendra dans ces parages). Il y a cette tension dans Jour entre la peur (du côté « pièce d’horreur », comme on dit « film d’horreur »), qui est quelque chose de très dramatique, et la pièce-paysage par où cette peur (et le dramatique) se dénoue.
Je ne sais pas ce que ça dit, et ce n’est pas le seul lien, mais l’important pour moi est de ne pas taire le théâtre, et de ne pas demander aux spectateurs de faire comme si aucun d’entre eux n’était au théâtre. Cette convention tacite (la dimension tacite de la convention, le clin d’œil silencieux de la scène à la salle) coûte très cher je trouve. Le théâtre est une ressource, un truc formidable, dans et par son étrangeté même, sa singularité.
IJ : Qu’est-ce que la mise en scène qu’a effectuée Alain Françon de tes textes à Théâtre Ouvert a confirmé ou infirmé de tes hypothèses théoriques concernant la scène ?
ND : Lorsqu’Alain a travaillé sur mes textes, il a proposé une différence qui m’a énormément éclairé par rapport au jeu, sur la différence entre l’interprétation et la production. Je formule la différence en mes termes : l’interprétation serait quelque chose qui se situe après le texte, dans son commentaire (jouer l’effet produit par le texte plutôt que jouer le texte), là où la production consiste… à produire le texte, c’est-à-dire à se situer en amont, avant lui, pour le produire dans sa justesse, le donner dans son éclosion textuelle.
Ça m’a beaucoup donné à réfléchir – y compris en contexte théorique – sur la place du texte (cette parole écrite) sur scène. Et je me suis rendu compte que mes pièces jouaient beaucoup sur l’étrangeté du texte. Plutôt que de chercher à effacer l’étrangeté de cette parole écrite, préparée, déjà là, plutôt que de chercher à la naturaliser, accentuer son étrangeté sur le plateau (étrangeté du texte par rapport à une situation vivante) peut être source d’une théâtralité affirmative. Sur le plateau, je me rappelle très nettement (j’assistais aux répétitions) d’un moment où Rodolphe Congé a trouvé ça par rapport au texte, dans la première longue réplique de Paul de Je pars deux fois. En jouant de manière tout à fait naturelle cette longue réplique (écrite), ça produit un effet de feu d’artifice, d’une grande inventivité verbale et de pensée. Alain a conduit le travail avec Rodolphe et Laëtitia Spigarelli dans ce sens, en travaillant sur la production du texte, la vitesse de pensée qu’il exigeait, etc. Ça m’a permis de comprendre un aspect de la spécificité formelle du texte de théâtre, « préparé » (et en ce sens non présent) là où tout sur le plateau est présent, et me donne des pistes pour travailler dans ce sens maintenant. Ça m’a aussi permis de conforter une orientation de travail : ce qui m’intéresse n’est pas de considérer le théâtre comme un autre monde, un double du « monde réel », c’est de faire voir au théâtre ce qu’on ne peut voir qu’au théâtre. Il me semble que ceux qui ont envie d’aller au théâtre ont envie de voir du théâtre, alors autant que ce soit clair ! – autant aggraver, pour ainsi dire, la différence théâtrale, pour donner à voir des choses qu’on ne peut pas voir ailleurs ; dans mon travail, ça passe par des réflexions sur la forme scénique.
_____________________________
[1] Nicolas Doutey, Je pars deux fois et Jour, Paris, Editions Théâtre Ouvert, Tapuscrit 127, mars 2013.

